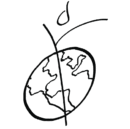Résumé du livre
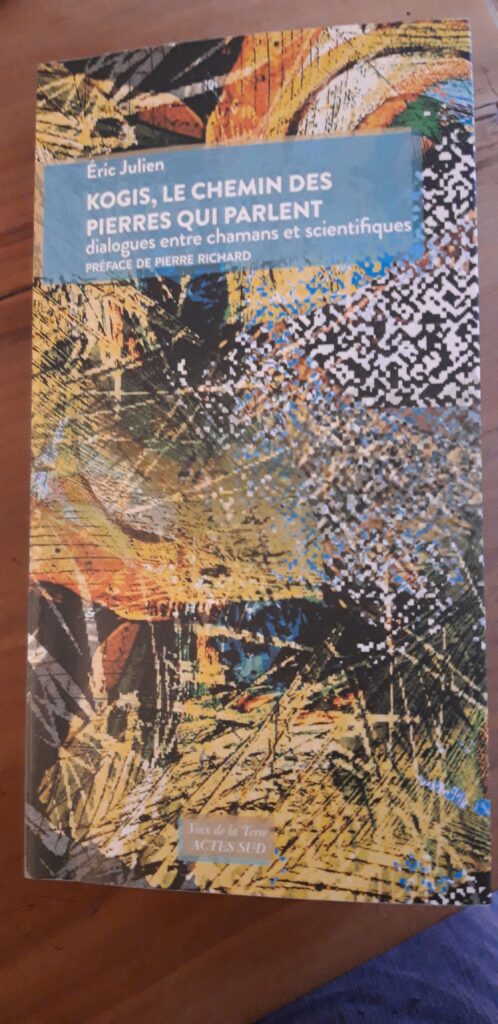
En 2018, trois sages du peuple Kogis (deux Mamas et une Saga), originaires de Colombie, sont invités dans le Haut-Diois (Drôme, France) pour réaliser un diagnostic territorial croisé avec une vingtaine de scientifiques français.
L’idée est de confronter deux visions du territoire — celle des Kogis, fondée sur des savoirs ancestraux, un rapport spirituel et sensible à la nature, aux roches, à l’eau, au vivant — et celle plus “moderne / scientifique”, pour voir où elles convergent, où elles diffèrent, et ce que chacun peut apprendre de l’autre.
Les Kogis considèrent le territoire comme un corps vivant, avec des circulations (de l’eau, de l’énergie), des points particuliers (comme des points d’“acupuncture”), et une interconnexion entre le visible et l’invisible. Ils parlent notamment du rôle des pierres, des roches — pas seulement comme matériaux ou éléments du paysage, mais comme éléments porteurs de mémoire, de relations énergétiques, d’équilibres écologiques.
Quelques citations de l’auteur, Eric Julien
« Engager un dialogue avec les sociétés “autochtones”, dont font partie les Kogis … ce n’est donc pas juste rencontrer des “autres”, c’est retrouver les voies de la réconciliation avec une partie de nous-mêmes que nous avons perdue. C’est “rentrer à la maison” et retrouver l’unité du vivant en nous et autour de nous. »
« Accepter de dialoguer avec les Kogis, c’est oser se positionner aux marges de ns référentiels scientifiques et conceptuels classiques. Et comme le rappellent Guy Parmentier et Bérangère Szostak de l’université de Grenoble, c’est toujours des marges que surgissent les plus grandes innovations. »
« Il est toujours intéressant de noter à quel points ceux et celles qui se réclament de la rigueur scientifique perdent leur capacité de discernement, voire sont capables de réactions les plus irrationnelles face à des phénomènes ou des pratiques qui interrogent leurs croyances et leurs certitudes. »
« Voir au-delà des apparences. Dans l’esprit des Mamas kogis, il ne s’agit nullement d’une métaphore, mais bien d’une réalité. Percevoir l’invisible qui fonde, oriente et structure les phénomènes visibles. […] Nombre de grands sages, philosophes, poetes, parmi lesquels Charles Baudelaire, ont souvent évoqué cette vision du monde : « La matière n’est qu’apparence, le spirituel demeure la réalité profonde et cachée. » »
Mon point de vue
A l’heure de la prise de conscience mondiale de l’impact négatif de notre paradis contemporain très artificiel et fort illusoire, ce livre sur la rencontre avec les Kogis nous ramène à un besoin de retrouver un paradis naturel. Remettre la nature au cœur de notre vie, au cœur de nos pensées, au cœur de nos projections et créations. Changer notre façon d’appréhender le monde tout en gardant notre maîtrise de l’artifice. N’est-ce pas le challenge actuel ? Nos sociétés dites civilisées se sont tellement engagées dans l’illusion et l’artifice qu’elles en ont oublié leurs savoirs naturels. La planète a tout à gagner de ce partage des connaissances entre les différents peuples et leurs savoirs.
Des enseignements naturopathiques :
Question d’énergie vitale
Lorsqu’on appréhende les choses sous l’angle sensible, en se basant sur nos ressentis plus que sur notre réflexion, nous allons dans le sens de la circulation de cette force de vie, pour plus de fluidité et d’harmonie. Cette énergie vitale, sans nom mais omniprésente chez les Kogis, est chère aux naturopathes qui parlent de force vitale. On retrouve l’équivalent dans les traditions chinoises avec le Qi, Ki au Japon avec le Ki, Prâna en Inde, Lung au Tibet, Mana en Polynésie, Anima en Rome antique…. Quasi toutes les traditions parlent d’un souffle, d’un flux, d’une circulation. Cette énergie està la fois individuelle et cosmique : elle traverse le corps, mais elle est aussi présente dans la nature, les astres, les éléments. Elle est renforcée ou bloquée par nos comportements.
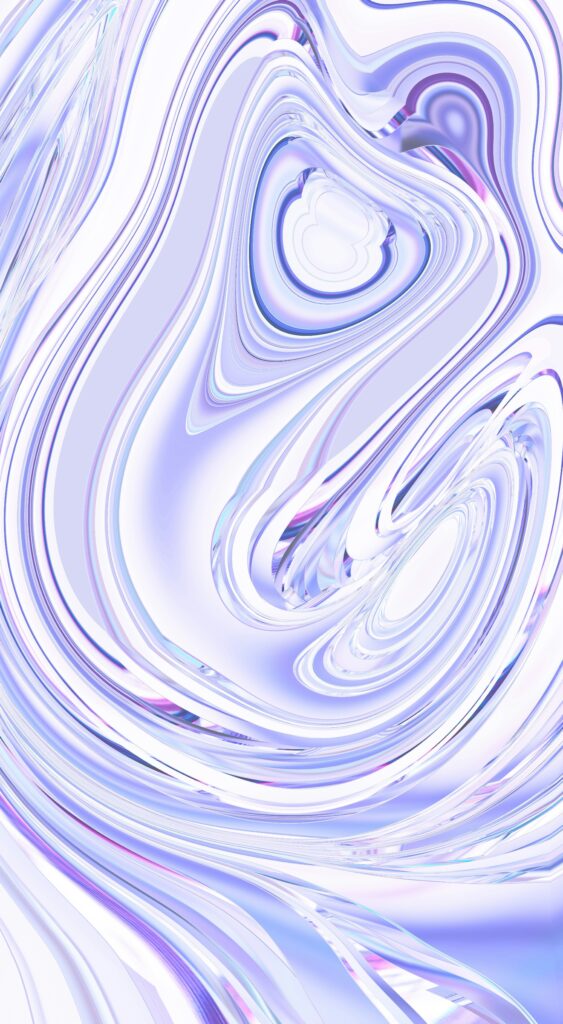
Notre rapport au monde
- Notre rapport à l’eau.
La très controversée question de la mémoire de l’eau est remise à l’ordre du jour par les Kogis, qui écoutent au quotidien ce l’eau leur raconte. Quand l’eau arrive chez nous, elle aurait en mémoire le traumatisme de des processus chimiques et physiques qui ont permis de la rendre « potable ». Même chose pour l’eau en bouteille. Au-delà de cette théorie, nous savons aujourd’hui que l’eau est notre bien le plus précieux pour notre survie. Elle constitue entre 50 et 70% de notre poids corporel. En prendre soin, la préserver, bien choisir son eau de boisson… à commencer par le première geste de la journée : boire un verre d’eau purifiée.
- Notre rapport aux éléments terrestres.

Nous pouvons considérer les éléments comme des êtres vivants. Par exemple, voir une rivière, un ruisseau, non pas comme une “ressource en eau” mais comme une entité qui nous relie à notre territoire, qui a sa mémoire, son rôle. Ça change la manière dont nous la respectons ou l’utilisons. Prendre soin des “pierres qui parlent”, passer du temps à observer des pierres, des montagnes qui nous entourent, ressentir ce qu’elles évoquent pour nous. Ça peut sembler symbolique, mais ça reconnecte à une attention fine au lieu. Nous pouvons aussi ritualiser certains gestes : boire de l’eau en conscience, remercier une source, un arbre, la terre avant de jardiner… Ce sont des micro-rituels qui renforcent le lien avec le vivant.
- Notre rapport au territoire.
Observer son lieu de vie comme un corps vivant : Où circule l’eau ? Où ça bloque ? Où sont les points “malades” ? C’est une manière intuitive mais puissante de diagnostiquer un territoire. Et peut-être d’agir à son humble niveau, en soignant plutôt qu’exploiter (replanter de l’endémique, nettoyer, restaurer des sols, protéger un espace naturel….). Relier visible et invisible : au-delà des données mesurables (qualité de l’air, biodiversité), nous pouvons aussi observer le ressenti des habitants : santé, sensations, harmonie, tensions ?

- Notre rapport à l’autre.
Valoriser les savoirs différents en partant de l’idée qu’aucun savoir n’a “toute la vérité”. Mettre en avant des points de vue variés, même si certains paraissent moins rationnels ou moins “experts”. Créer des espaces de dialogue où des gens de cultures, métiers, ou sensibilités différentes confrontent leurs visions d’un même problème.
Prendre le temps de l’écoute
Avant de prendre des décisions, ne serait-il pas intéressant de prendre un temps d’observation, d’écouter de son environnement, son corps, de regarder les petits signes extérieurs, d’être attentif ou attentive aux synchronicités, chères à Carl Gustav Jung, de ralentir…. avant de passer à l’action ?

Chacun de nous peut à son échelle avoir un rôle sur ce mouvement pour redevenir sensibles. Dans sa vie quotidienne, dans ses projets, dans les enseignements que nous laissons à nos enfants, nos petits-enfants, dans l’exemple que nous donnons autour de nous. Prendre soin de soi, de son corps et de l’énergie vitale qu’il abrite, comme un point d’acupuncture pour tout ce qui nous entoure. Prendre soin de soi pour prendre soin du monde.
Je remercie tout particulièrement mon amie Vanina qui m’a offert ce livre à l’ouverture de mon cabinet de naturopathe. ![]()
En savoir plus sur TERRE & ÊTRE
Subscribe to get the latest posts sent to your email.